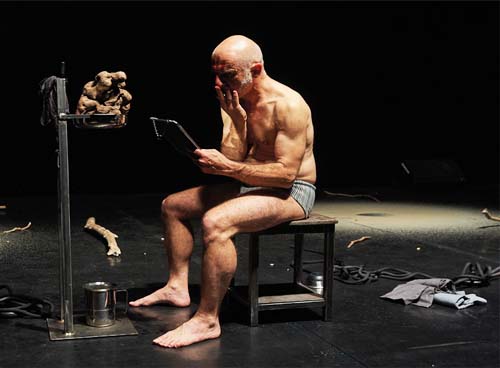Merveilleux nuages
Délicieux spectacle de nouveau en scène, Tête en l’air par la compagnie Les petits pois sont rouges était donné à l’espace Jean Ferrat de Septèmes-les-Vallons à un public d’enfants aux parents et proches ravis d’avoir « dû » les accompagner. Une scénographie minimaliste structure le plateau par la ligne aérienne d’un fil à linge tendu entre une échelle double et un rideau qui en efface la fin, offrant une première énigme géométrique, début d’infini au cœur de la proposition à venir. Espiègle, la comédienne Cécile Rattet suspend grâce à des épingles à linge des pièces de vêtements (en fait, des papiers découpés en forme de chaussettes, pantalons, T-shirts, culottes) dont les plis sont soigneusement aplatis. Une touche de couleur suscite le rire du personnage qui semble tout découvrir avec émerveillement, tandis que l’univers sonore dessine le vent, le calme chant des oiseaux, le cours d’une petite rivière qui sera franchie en sautant sur les cailloux blancs que sont devenus les tissus de papier pliés et roulés. Des nuages naissent de la danse joyeuse de voiles de brume légère

Le quotidien s’enchante avec une poésie délicate à laquelle le public enfantin est sensible. Il suivra avec intérêt la petite marionnette née d’une nuée qui s’ingénie à taquiner sa manipulatrice, à explorer ce qui l’entoure, à produire des flocons de neige. Aucune parole : sourires, mimiques, gestes, objets, compositions musicales ou sonorités piochées dans la nature, suffisent à construire un univers tout de finesse où les nuages dialoguent avec un rayon de lune à l’ombre duquel il fait bon s’endormir. Magie de l’instant…
Spectacle donné le 9 février à l’espace Jean Ferrat, Septèmes-les-Vallons, dans le cadre du dispositif départemental Provence en Scène.