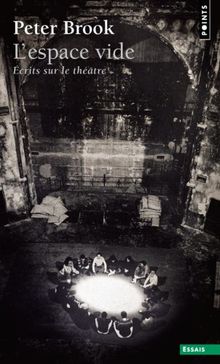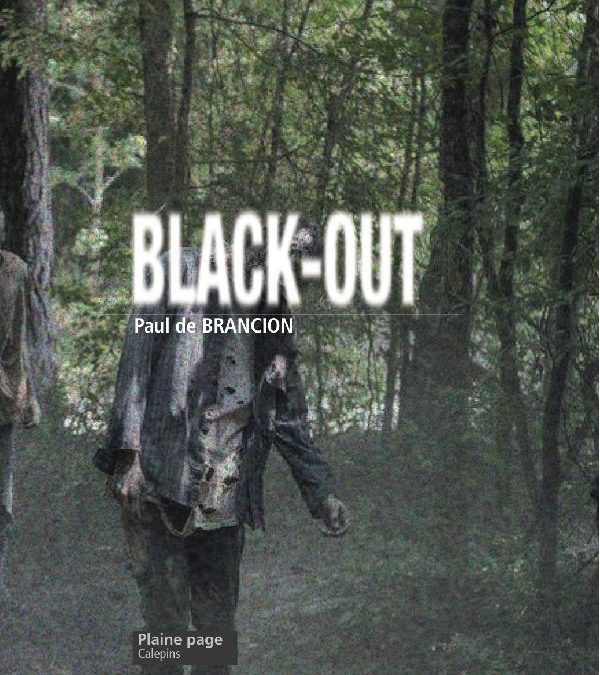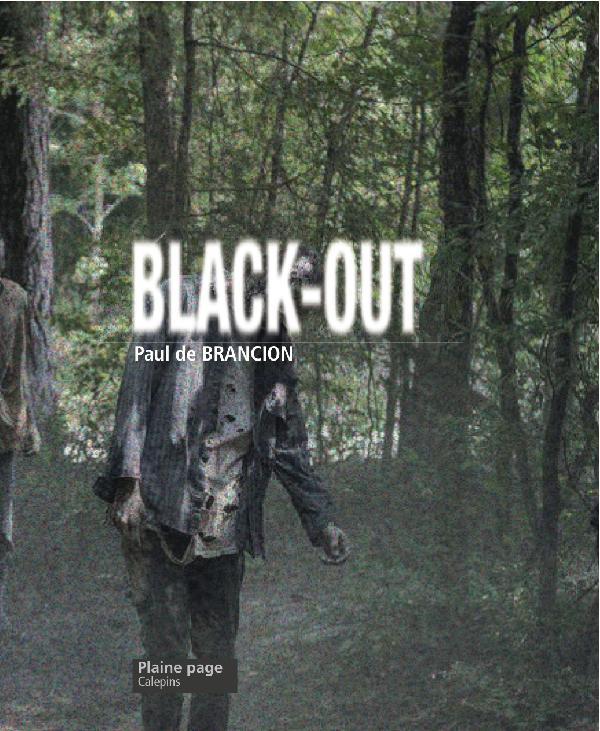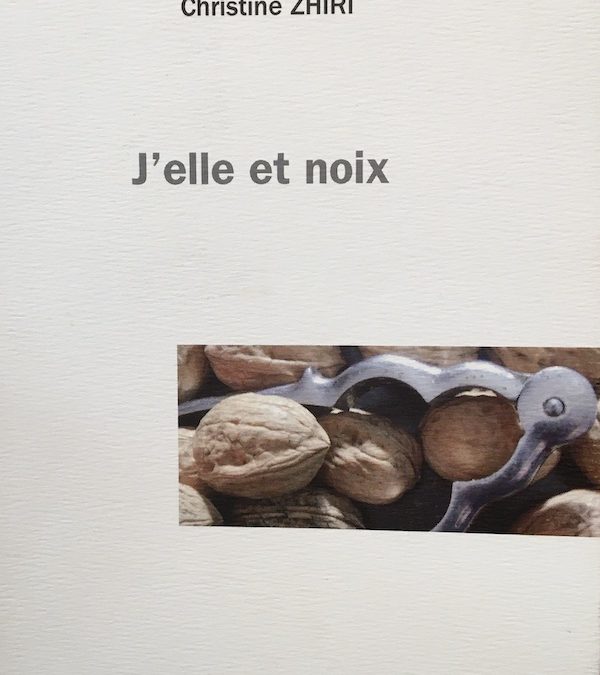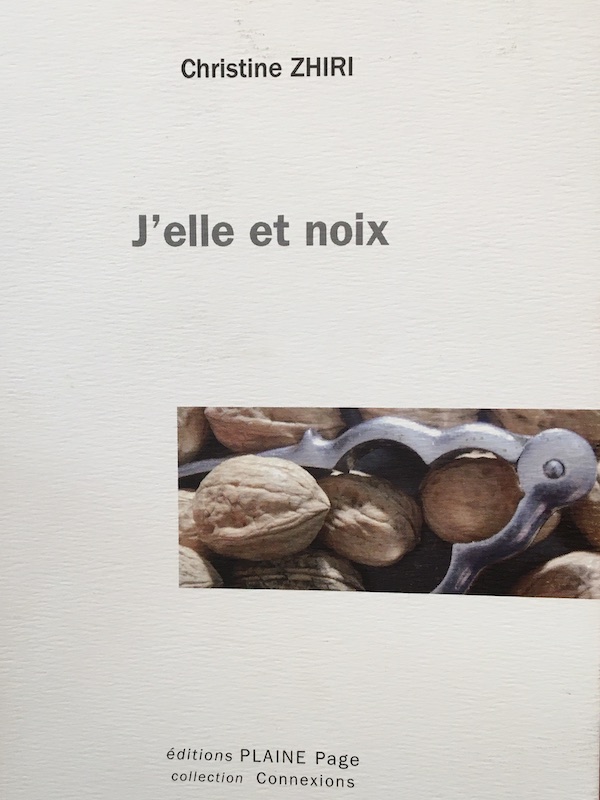Une nécessaire distance
Pour les quarante ans cette distance peut être celle entre le souffle et les bougies, la joie et la fierté du chemin parcouru, l’angoisse et le bonheur de celui à poursuivre. La fabuleuse équipe du théâtre du Maquis est prête à des lendemains qui chantent et dansent et créent. Pour le moment, pause sur image, une rétrospective non exhaustive mais transcrivant avec humour et espièglerie les quarante années passées, par tranche de dix ans en quatre soirées festives où boisson et repas (« on ne sait pas du tout ce que notre cuisinier a fabriqué, c’est une surprise aussi pour nous ! » s’amusent les comédiens qui servent au public de petites boites métalliques, référence malicieuse au nom du lieu, l’Ouvre-boîte qui lui-même doit son nom à l’aïeul qui fabriquait ces ustensiles nés de la révolution industrielle) sont offerts dans la bonne humeur. « Gardez vos cuillères pour la suite ! ».
Le titre programmatique, Seule la légende est vraie, donne le ton : foin des exactitudes et du recensement méticuleux ! L’essentiel n’est pas là malgré le côté « Lagarde et Michard » (ces livres qui présentaient siècle par siècle un panorama de la littérature française aux lycéens d’une autre époque), qui découpe en décades la formidable aventure de la compagnie fondée par Florence Hautier et Pierre Béziers en 1982 pour une première création en 1983 (Trompe-l’œil) : 1983-1992, Le début de la fin, 1993-2002, Vogue la galère, 2003-2012, La traversée du désert, 2013-2023, Un faux départ (occasion de réviser le célèbre Chant du départ des partisans, le théâtre est malgré tout et toujours une histoire de résistance)…
Les 40 ans du théâtre du Maquis © Théâtre du Maquis
Les références aux spectacles s’égrènent, bribes, échos, supports de réminiscences heureuses. Certaines pièces ne sont plus directement liées au théâtre du Maquis, mais sont empruntées aux créations des enfants des fondateurs, eux aussi infatigables artistes, Jeanne Béziers, comédienne hors pair, aussi à l’aise dans les registres « sérieux » que dans ceux du rire (sa force comique offre des intermèdes tordants qui noient la nostalgie dans leurs éclats) et Martin Béziers dont les créations musicales, inventives et décalées, nourrissent la trame des souvenirs. Certes, les deux artistes ont monté leurs propres groupes, macompagnie pour la première, Les Brûlants pour le second.
Comment naissent les légendes
Le trou, le trac, l’oubli, sont au cœur de ces pages d’histoire. Comment rendre le passé sans le remodeler : chacun formule sa version, chacune est vraie et fausse ou inventée, on ne sait pas, on ne veut pas chercher plus loin ; la magie du théâtre tient à ces faits dont la véracité n’est pas importante : seul le récit compte.
Ses fils s’entrelacent, parcourent le monde, transforment les adresses, les lieux, les climats, les scénarii, le vécu se retisse en une trame mouvante.
Jeanne évoque le trou de mémoire sur scène : le fait de se sentir si proche d’un personnage ou d’une situation alors que l’on est sur scène est dangereux !
On se met dans la peau du spectateur, si bien que l’on perd le fil des mots noués par l’intrigue.
La distanciation, même, surtout, au cœur de l’action est nécessaire.
Les anciens costumes retrouvent le chemin de la scène, les répliques se réinventent, prennent une nouvelle couleur dans leurs juxtapositions fantaisistes.
Les chorégraphies de Clara Higueras construisent de fulgurants intermèdes en joutes flamenquistes avec les musiciens, les chansons accompagnées par un orgue de Barbarie permettent des « changements de décor »…
Les 40 ans du Maquis © Théâtre du Maquis
On rit, on chante avec les artistes, on se souvient. L’émotion parfois gagne, mais on est au théâtre, une pirouette remet sur les fantastiques chemins de l’illusion. Longue vie à cette belle machine à rêves !
Les quarante ans du théâtre du Maquis ont été donnés du 10 au 13 mai à l’Ouvre-Boîte, Aix-en-Provence