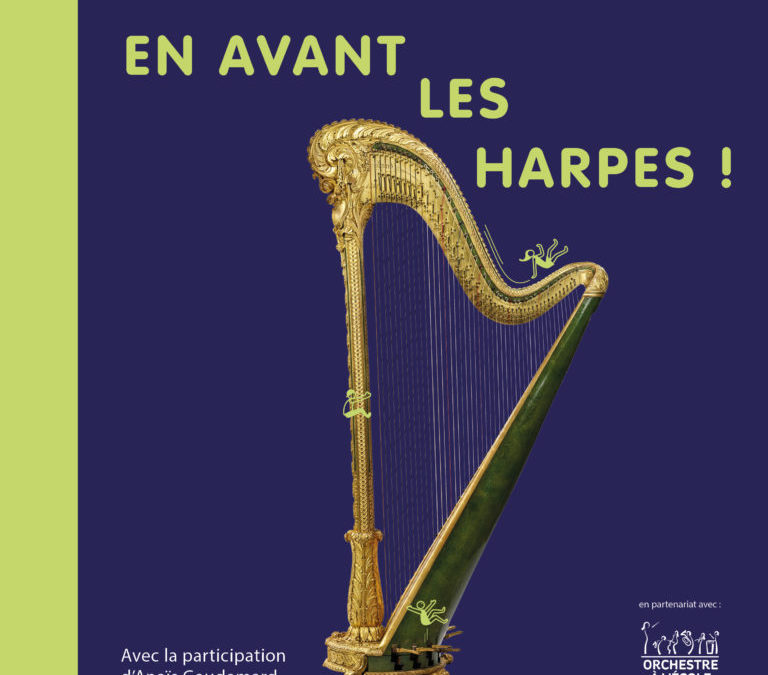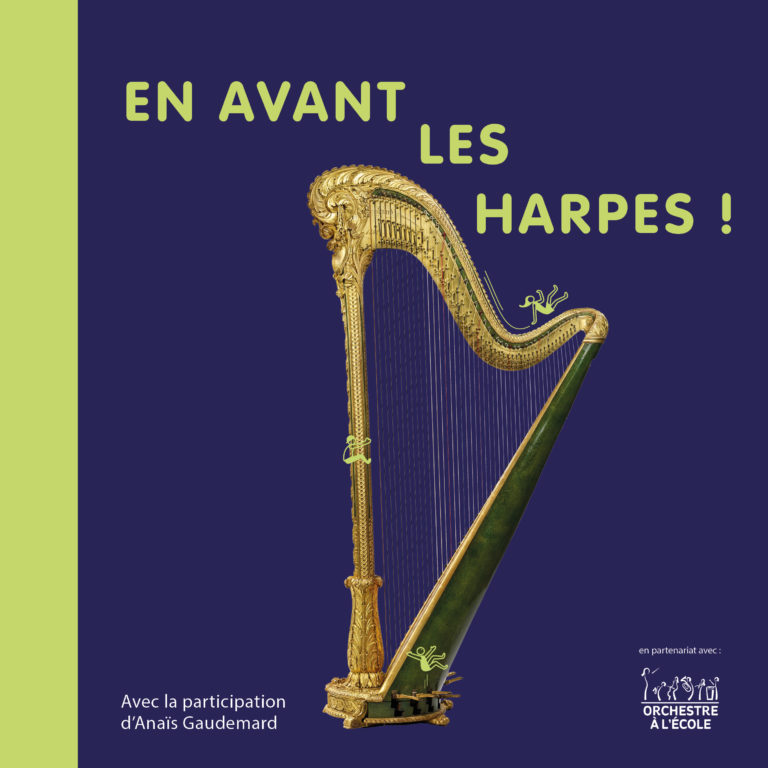Les récitals du clavier à marteaux
On l’avait entendu en 2021 au Festival de La Roque d’Anthéron au Centre sportif et culturel Marcel Pagnol (ici) et c’est avec bonheur qu’on retrouvait Vadym Kholodenko sous la conque du parc de Florans pour l’édition 2025 lors de l’avant-dernier concert de cette manifestation qui sait si bien célébrer le piano.
Certains appréhendaient la première partie du spectacle : la célèbre Sonate n°29 en si bémol majeur opus 106 dite Hammerklavier et dédiée par Beethoven à l’archiduc Rodolphe sous le nom de « Große Sonate für das Hammerklavier » (grande sonate pour piano-forte) est un Everest pianistique et rares sont les virtuoses à pouvoir espérer la jouer d’une façon convaincante !
L’exceptionnel pianiste qu’était Beethoven n’en était pas dupe. Lorsqu’il en confia le manuscrit à son éditeur, il aurait affirmé : « voilà une sonate qui donnera du fil à retordre aux pianistes, quand on la jouera dans cinquante ans ! ». Ce en quoi il se trompait : Liszt la joua lors de ses concerts. Vous direz « oui, mais c’était Liszt ! ».
Est-ce en souvenir de cet épisode que Vadym Kholodenko unit les deux compositeurs dans son programme ?
Le « jeune » instrument, inventé par le facteur italien Bartolomeo Cristofori vers 1700 est en train de détrôner ses prédécesseurs, dont le clavicorde, et Beethoven a enfin trouvé un instrument à sa démesure. Dans sa Sonate Hammerklavier, il semble vouloir expérimenter tout ce que l’on peut faire avec ce merveilleux instrument qui déploie une palette inaccessible auparavant, jusqu’à reprendre parfois les accents du clavecin !
Vadym Kholodenko rend sensibles ces couleurs et ces variations nouvelles grâce à son jeu d’une élégance déliée et une approche qui peut être aussi puissante que délicate. Les quatre mouvements de la sonate voient passer tous les états d’une âme par tous les moyens techniques possibles. Beethoven est alors totalement sourd et pourtant a lieu le miracle d’une musique qui nous transcende. La matière même du son architecture le morceau, jonglant entre polyphonies somptueuses et simple mélodie. Les contrastes et les métamorphoses de l’étoffe sonore apprivoisent les limites. Le pianiste laisse aux silences leur poids dramatique et la musique semble alors éclore comme la création d’un premier jour, effluves d’une douceur infinie ou orages démoniaques font pressentir les tensions qui animent le compositeur. On est subjugué par l’immense Adagio sostenuto, porté par une forme d’exaltation qui sourd de l’indicible poésie de ce mouvement lent qui joue sur l’infime, dentelle d’éternité que vient habiter le mystérieux Largo conclu par un Allegro risoluto aux pyrotechnies ébouriffantes. Cinquante minutes ce Hammerklavier ? Impossible ! Les montres ne s’accordent pas au temps réellement suspendu qui a emporté l’auditoire dans un univers aux ineffables nuances !
Sans interruption, la seconde partie enchaînait Trois études de concert S.144, Quatre valses oubliées S.215, Valse-Impromptu en la bémol majeur S.213 et Scherzo et Marche de Liszt, comme si l’interprète se refusait à quitter ne serait-ce qu’un instant le haut degré de concentration dans lequel il plonge pour transmettre le sel des œuvres présentées. La fougue virtuose de Liszt brille grâce à Vadym Kholodenko tout au long de cette partie qui ne cesse de réinventer l’art pianistique. La feuille de salle (je n’ai pas encore dit à quel point ces fiches sont intéressantes et éclairantes, et ce pour chaque concert du festival, un travail plus que remarquable !) évoque Liszt comme l’initiateur du récital d’aujourd’hui.
Le terme lui-même se trouve pour la première fois écrit en français, sans accent et entre guillemets, sous la plume de Mallarmé.
Le mot fut utilisé par les publicités placardées sur les murs des Hanover Square Rooms (salles de concerts) de Londres en 1840 pour annoncer un concert donné par Liszt : « Mr. Liszt will give, at Two o’ clock on Tuesday morning, June 9, RECITALS on the PIANOFORTE on the following works : Scherzo and finale from Beethoven’s Pastorale Symphony, Serenade by Schubert, Ave Maria by Schubert, Hexameron, Neapolitan Tarentelles, Grand Galop chromatique. » « How can one recite on the piano ? » s’interrogea la presse.
Franz Liszt s’était demandé comment nommer ses spectacles au cours desquels il jouait par cœur tout son programme devant un public d’anonymes payants (le concert privé devant un cercle d’amis et de connaissances était en vogue, même si, en 1725, Philodor avait fondé le Concert spirituel, institution qui permettait à tous d’aller écouter, en payant sa place, de la musique). Le piano était ouvert vers la salle pour que le son y soit renvoyé. Il avait songé à d’autres formulations mais peu « vendeuses », « monologue » ou « soliloque » musical ou pianistique… ce serait le musicien anglais Frederick Beale qui lui aurait suggéré « recital », autrement dit, une déclamation publique, par cœur.
Pleinement conscient de la nouveauté de ce qu’il proposait, Liszt, dans sa légendaire modestie, et sans doute beaucoup d’humour, affirma : « J’ai osé donner une série de concerts à moi tout seul, tranchant du Louis XIV, et disant cavalièrement au public : le concert, c’est moi ». Il semblerait même que souvent Liszt avait deux pianos sur scène avançant la raison de la casse fréquente des cordes, ce qui donne une certaine idée de son jeu, mais surtout dit-on, pour faire admirer ses deux profils…
Beethoven s’était hissé au même niveau que son successeur en s’imposant comme un égal des aristocrates qui prenaient les compositeurs pour des valets, et se serait exclamé : « Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. Il n’y a qu’un seul Beethoven ».
Le génie de Kholodenko est d’avoir réuni ces deux géants en un même « récital », et d’avoir accordé sa verve et sa sensibilité à leur mesure.
À l’ovation qui accueillit les dernières notes du concert, le pianiste répondit avec espièglerie : « ce sera très court ». En effet, il joua l’œuvre musicale la plus brève, les onze mesures que Beethoven avait nommées Onze bagatelle opus 119 : Allegramento n° 10 en la majeur. On ne peut lui comparer que le monostiche d’Apollinaire, le poème le plus bref de la langue française, paru dans Alcools sous le titre Chantre : Et l’unique cordeau des trompettes marines.
Récital donné le 16 août 2025 au parc de Florans dans le cadre du Festival de La Roque d’Anthéron
Toutes les photographies de l’article sont signées Valentine Chauvin
Article paru dans Zibeline à propos du premier concert de Vadym Kholodenko à La Roque :
Le piano, nouvelle discipline olympique ?
Vadym Kholodenko : un poète à la Roque
Se réfugiant à l’abri du Centre sportif et culturel Marcel Pagnol, le récital de Vadym Kholodenko ne se plaçait pas sous les meilleurs auspices : au délicieux ombrage des grands platanes du parc de Florans qui enveloppent les concerts de leur frémissement aquatique, était substituée une grande salle de sport, ornée de ses paniers de basket, dans la lumière crue de ses spots… Rien de bien intime dans cet espace nu face à des gradins de supporters.
Et pourtant, la magie opère, on se trouve englobé dans la bulle poétique créée par la subtile interprétation que nous livre Vadym Kholodenko. La clarté du jeu se conjugue au moelleux des notes avec une délicate intelligence dans les quatre Duettos pour clavier BWV 802 de Jean-Sébastien Bach, puis dans la Sonate 28 en la majeur opus 101 de Beethoven qui l’évoquait comme « une série d’impressions et de rêveries ». Et l’on a la sensation d’entendre le compositeur rêver sur le clavier, échos entre les phrases, revirements, murmures, éclats, comme une pensée en train de se construire. L’allégresse des syncopes dans le Vivace alla marcia rééquilibre les passages d’une gravité recueillie. Le Polichinelle de Rachmaninov, extrait de Cinq morceaux de fantaisie opus 3, nous fait entrer dans la musique de caractère, véritable danse où l’aisance et la mélancolie se mêlent. Sans pause, s’enchaîne la Sonate n° 2 en si bémol mineur de Rachmaninov. Ramifications souterraines, éclosions, élans brillants auxquels succèdent des lignes d’une pure sobriété… Le pianiste enchante la partition, laissant de larges envolées romantiques embrasser le monde de leur respiration, ou éclater des déluges de notes en somptueux feux d’artifice. Lors du bis, en accord avec la douceur de la pluie du dehors, la Polka de W.R. de Rachmaninov fait perler ses notes liquides et les nimbe de silence, puis, le Prélude d’Alexey Kurbatov conjugue sa légèreté enjouée à la virtuosité de l’exécution.
MARYVONNE COLOMBANI
août 2021
Concert donné le 4 août 2021, après-midi au Centre sportif et culturel Marcel Pagnol de La Roque d’Anthéron, dans le cadre du Festival international de piano de la Roque d’Anthéron