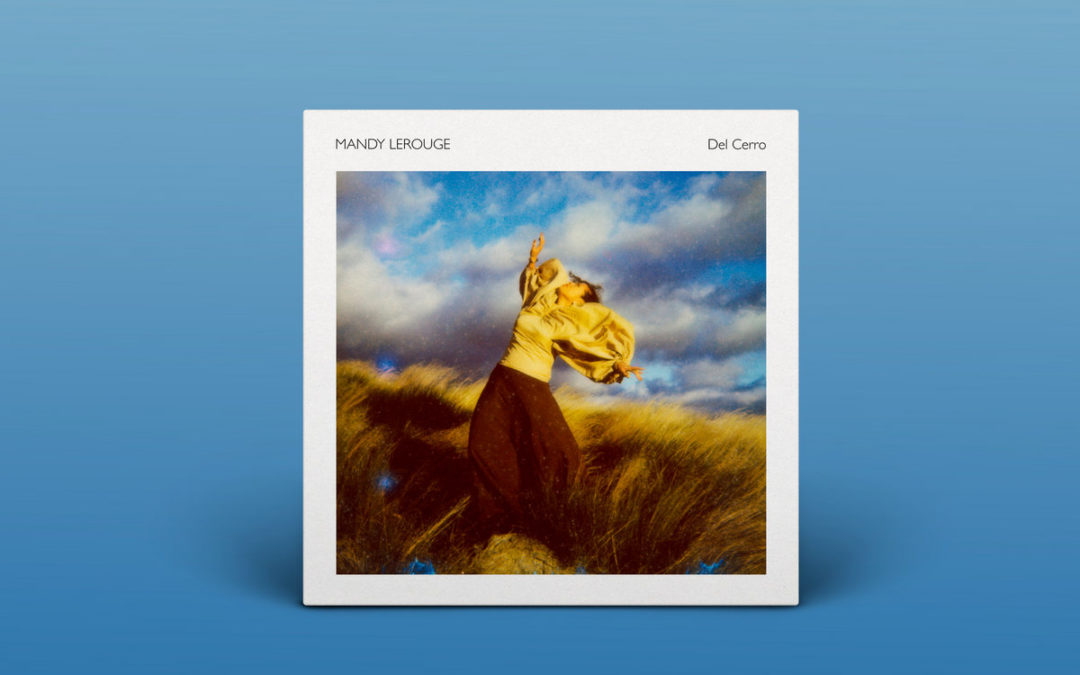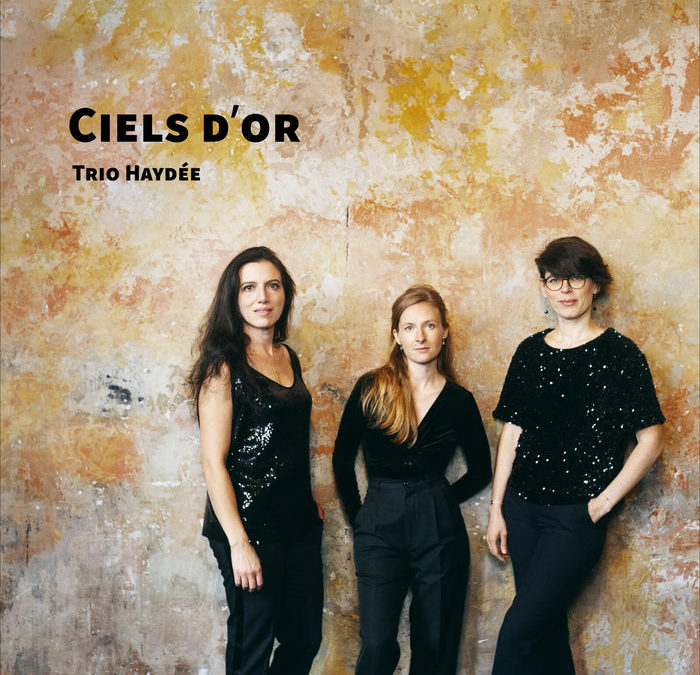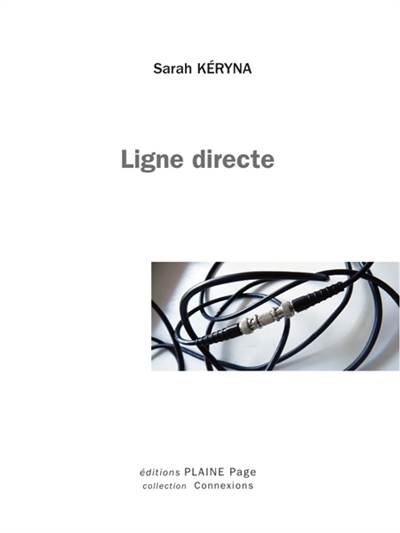De l’art de l’amitié
La venue du violoniste Renaud Capuçon à Aix-en-Provence résonne comme un avant-goût du prochain Festival de Pâques, manifestation qu’il a fondée en 2013 avec Dominique Bluzet et le président du CIC. Dans l’écrin du Grand Théâtre de Provence, il est un peu comme « à la maison ». Aussi, il invite des musiciens qu’il apprécie. Sachant bien qu’aucune étoile n’en efface une autre mais lui apporte sa lumière, il s’entoure de jeunes et talentueux instrumentistes qu’il se plaît à mettre en avant. Ainsi, le pianiste Guillaume Bellom, l’altiste Paul Zientara et la violoncelliste Julia Hagen. Chacun apporte sa palette, sa sensibilité, son intelligence délicate des partitions et la fusion de ces personnalités fortes qui s’écoutent les unes les autres est mise au service d’interprétations sans failles, nourries d’échos, de fulgurances, de mélodies, de rythmes. Le livre d’images s’ouvre, et l’auditoire plonge dans un univers aux fragrances subtiles, découvrant et redécouvrant les auteurs connus dans des œuvres peu souvent jouées.
Surprises de la modernité
On apprend ainsi à se méfier des idées toutes prêtes que l’on accole à tel ou tel compositeur. Le Quatuor avec piano que le jeune Mahler (il avait seize ans) écrivit alors qu’il n’était encore qu’étudiant au Conservatoire de Vienne débute par un piano qui semble hésiter, puis qui accompagne les cordes comme pour un lied. La mélodie du violon très courte est en proie à un indicible tourment quasi-tragique puis s’emporte en allegro.
Le premier mouvement et seul entièrement achevé par le compositeur est précédé d’un « nicht zu schnell » (pas trop vite) et pourtant est habité d’une sourde tension. Le deuxième mouvement (on ignore si Mahler voulait écrire les quatre mouvements de la forme classique du quatuor) est inachevé (24 mesures) et le compositeur Alfred Schnittke l’a complété avec ses propres préoccupations en 1973, si bien que l’auditeur est surpris tout d’abord de l’étonnante modernité de cette pièce mahlérienne.
Guillaume Bellom © J-B. Millot
Les dissonances neuves, les croisements de phrases montantes et descendantes, la puissance interne du texte, les émois pianistiques très « XXème » prennent alors tout leur sens dans cette passation où les siècles se complètent et les romantismes se catapultent.
On était subjugués ensuite par la beauté du Quatuor pour piano et cordes n° 2 en sol mineur opus 45 que Gabriel Fauré dédia au pianiste et musicologue Hans von Bülow. La plénitude de la partition accorde aux instruments des dialogues d’une fine complexité, varie les rythmes, dénoue les gammes, dessine des paysages, ombre les âmes d’une indicible mélancolie, mène à des sommets, flirte avec les orages, joue des contrastes, passant de la sérénité d’une rêverie aux ostinatos véhéments du piano dans la dernière section.
Julia Hagen © Julia Wesely
Le jeu lumineux de Guillaume Bellom est en osmose avec les cordes qui se rejoignent sur des phrasés aériens. Tout aurait pu s’arrêter là tant l’émotion était forte.
Après l’entracte, un autre chef d’œuvre était mis en scène, le Quatuor pour piano et cordes opus 13 de Richard Strauss. Certes, on aime comparer et déceler des influences, surtout dans une œuvre qui fait partie des plus importantes de la musique de chambre du jeune Strauss.
Il compose son Quatuor en 1885 (il a 21 ans). Cette pièce frappe par ses dimensions en quatre mouvements et est souvent rapprochée des quatuors avec piano de Brahms auquel le jeune compositeur vouait une sincère admiration à l’époque (il parla de son « enthousiasme » pour le musicien). Elle reçut le Prix de l’Association des compositeurs berlinois en 1886 (Berliner Tonkünstlerverein). Il est vrai que Richard Strauss écrit pour des instruments qu’il connaît bien : il a débuté le piano à quatre ans, le violon à six et la composition à onze. Il écrivit à douze ans un Festmarsch pour grand orchestre.
Paul Zientara © Tatiana Megevand
Parallèlement à ses dons musicaux il entra à l’Université de Munich à seize ans pour y suivre des cours de philosophie et d’histoire de l’art. Il manie dans ce quatuor d’une manière très maîtrisée les alternances de contrastes, les moments passionnés et les instants de recueillement, les respirations impétueuses et les souffles retenus. Les quatre instrumentistes trouvent ici un équilibre idéal, en une alchimie complice qui ne se refuse pas des mouvements d’humour et des répliques enjouées avant un final Vivace brillant. Ils reprendront en bis le spirituel et pittoresque Scherzo.
Concert donné le 28 février 2025 au Grand Théâtre de Provence