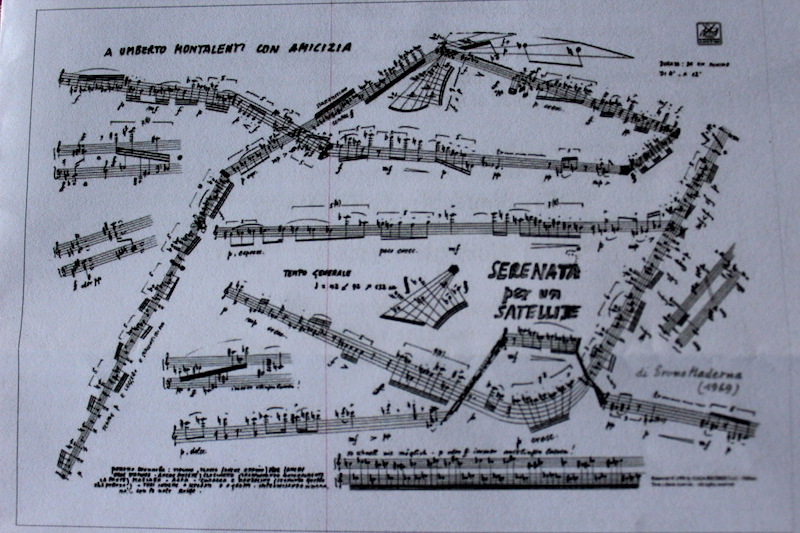Voyage in Leleuland
« Born to groove » en création mondiale au GTP, une histoire forte d’enfances et de passions musicales sans frontières
Après des retrouvailles rocambolesques avec son tuba qui a mis trente heures pour effectuer le transit de Berlin où vit l’ancien tuba solo de l’Opéra de Marseille, à Aix, le jeune prodige Thomas Leleu déclinait son amour du « cross-over » au Grand Théâtre de Provence dans une création mondiale de Born to groove (CD paru le 21 mai 2021) en adjoignant à ses complices Laurent Elbaz (piano, claviers, arrangements), Yoann Schmidt (batterie), Kevin Reveyrand (basse), Jérôme Buigues (guitare) et François Chambert (saxophone, clarinette), l’Orchestre du Conservatoire Darius Milhaud placé sous la houlette de Michel Durand Mabire. Relier les instruments jazziques et ceux de l’orchestre « classique » permettait au musicien d’unir sur un même plateau ses goûts éclectiques, sa formation classique et son amour du jazz.
En préambule à la soirée, le tubiste livrait quelques explications sur l’histoire de l’instrument tuba et la multiplicité de ses formes, ce qui justifiait le désarroi général lors de l’attente interminable qui devait ramener son propre tuba à Aix, (le seul trouvé au conservatoire qui aurait pu le remplacer ne convenait pas vraiment !). Puis il donnait quelques pistes biographiques son parcours, le choc ressenti à la découverte de la mythique compagnie de disques Motown à neuf ans, son amour du jazz qu’il jouait en cachette entre les cours traditionnels du conservatoire, évoquait les encouragements de son frère : « suis ton instrument ! ». « En effet, sourit le jeune musicien, c’est lui qui me mène. Dans ce spectacle il y a des compositions que j’ai faites à quinze ans sur le piano de ma mère, j’en avais gardé les enregistrements. Ici, c’est un rêve d’enfant, d’ado, qui se réalise ».
Thomas Leleu @ Thomas Ales
Révélation instrumentiste aux Victoires de la Musique 2012, le « Paganini du tuba » apporte sa fraîcheur sa curiosité, son empathie, son intelligence, sa vivacité : la scène semble se transformer en cour de récréation, en lieu de tous les possibles, univers de joie partagée, de souvenirs, d’émotions. La musique voyage, nous donne rendez-vous en Afrique, au Brésil, s’attarde sur le Corcovado et la plage de Sao Paulo. Celui qui « rêvait de vivre toutes les musiques » part à la rencontre des lieux de la planète, le transcrit dans sa propre pâte, rend lumineux son Melton Meinl Weston, dialogue avec les autres instrumentistes dont les solos éblouissants se lovent sur les nappes sonores de l’orchestre.
Le tuba, cet instrument délaissé, « un quart d’heure sur les six d’un opéra de Wagner », devient le socle des mélodies et des rythmes, s’envole en improvisations élégantes et passionnées, épouse la danse de son instrumentiste. Un thème de Schubert vient flirter avec le swing, on s’envole pour « Leleuland » (nom donné par le pianiste et arrangeur, fidèle depuis les débuts du jeune soliste). Le monde s’ouvre à tous les courants les mêle sans les oblitérer. On est touché par la capacité intacte d’émerveillement de l’enfant devenu grand et qui a la planète comme aire de jeu. Un appel à la beauté des êtres et des choses plus que nécessaire alors que la folie de certains cherche à la nier.
Concert donné le 2 décembre au GTP, Aix-en-Provence