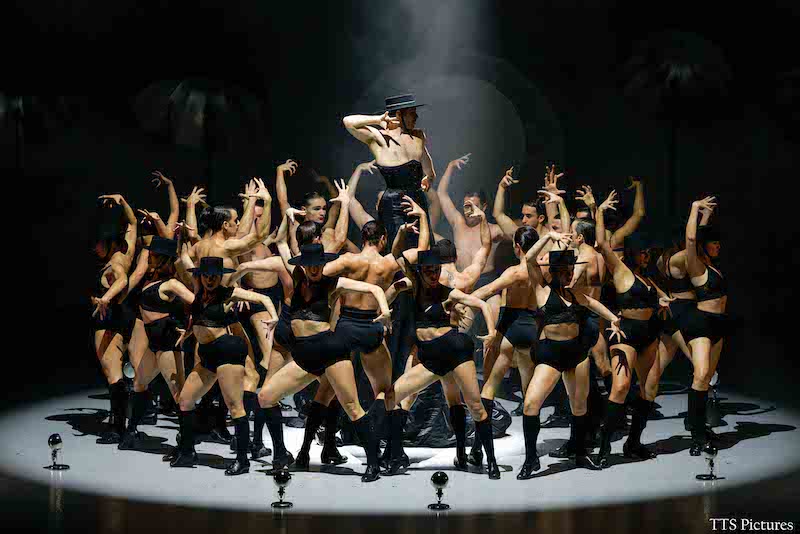Et si ?…
Bien sûr, avec des si… les fantaisies se rêvent concrètes quoiqu’impossibles. Une exception est à signaler ! Le spectacle Tu connais la chanson ? concocté par Charlotte Adrien et Louis Caratini qui articule sa note d’intention autour de quatre questions débutant par « Si », puis une succession de « Et si », fait entrer concrètement son public dans univers inoubliable de mots, de rires, de parodies, d’inventions, d’improvisations, de réflexions pas si légères malgré les apparences… Dans cette même note, les termes du jeu (« s’amuser », « jouer ») côtoient à égalité ceux plus didactiques de l’apprentissage (« apprendre »x2) et c’est ce qui se passe dans cet inclassable spectacle.
Seul sur le plateau, Louis Caratini arbore une large surchemise à carreaux sur kilt et t-shirt noirs : clin d’œil aux robes noires de nombreuses chanteuses, Piaf et Barbara en tête? « Je souhaitais surtout être à la fois féminin et masculin dans ce spectacle qui évoque des chanteurs et des chanteuses, une manière d’être à la fois les uns et les autres, sans cultiver d’ambigüité, le kilt est malgré tout un vêtement masculin… » expliquera-t-il après le spectacle. On le voit évoluer avec aisance dans la mise en scène fluide, rapide, pertinente de Charlotte Adrien avec laquelle l’artiste a concocté le texte du spectacle, ton léger pour une architecture documentée qui mène le public dans les méandres de la chanson française, interroge cet art populaire et savant à la fois et nous fait percevoir l’infinie richesse des textes et des mélodies et le petit miracle qui les fait s’accorder entre eux.
Tu connais la chanson? / Louis Caratini © Jérôme Quadri
Pourquoi une chanson ? À quoi sert-elle ? Qu’est-ce qui fait « chanson » ? Où commence et s’arrête la propriété intellectuelle alors que les chansons « courent dans les rues » ?
Entre réflexions, anecdotes, « blind test », improvisations géniales et pastiches tordants, les standards de la chanson francophone défilent. Au détour d’un accord, on découvre de nouvelles paroles, on se remémore d’autres que l’on croyait oubliées.
« On a tendance à croire en France qu’une chanson, ça se fait tout seul ; mais est-ce qu’on écrit vraiment jamais tout seul ? Comment ça se fabrique une chanson ? » demande le musicien qui invite la salle à lui répondre. Peu à peu les mots fusent, les explications s’esquissent… complexe le sujet ! « La chanson se situe entre la poésie, le théâtre, la mélodie », sourit-il, convoquant un florilège (il ne s’agit pas de mettre en œuvre un dictionnaire de la chanson francophone, il faudrait y passer des semaines !) de pièces. Certaines chansons seront jouées intégralement, d’autres juste effleurées lors de blind test auxquels la salle participe avec passion (l’artiste rebondit avec aisance sur les suggestions des spectateurs qui sont autant de sources de rires et de complicité partagés), d’autres encore fusionnées en medley vertigineux lorsque leurs mélodies seules ne sont pas cousues ensemble afin de nous raconter de véritables histoires.
Tu connais la chanson? / Louis Caratini © Jérôme Quadri
Tout commence après une introduction vocale débridée par Les Mots de La Rue Ketanou (« Un mot pour tous, tous pour un mot ! »). La fascination pour les textes conduira le poète de la scène à aborder une phalange d’auteurs, de Brassens à Diane Tell, d’Higelin à Angèle… après être « tombé du ciel » (Jacques Higelin), Louis Caratini au piano offrira une très belle version de Sur mon chemin de mots d’Anne Sylvestre. La question sera posée : pourquoi Barbara est plus connue qu’Anne Sylvestre alors que cette dernière est le premier modèle de femme à avoir produit la quasi-totalité de son travail? « Women Power » et poing levé !
Le rire n’est jamais loin pourtant et les zygomatiques sont mis à rude épreuve, que ce soit lors de l’introduction parodique à la guitare de Ma philosophie d’Amel Bent, de l’inénarrable moment de raggamuffin délirant ou le pastiche des accompagnements instrumentaux, en passant par la guitare, la contrebasse ou le piano, moment de haute voltige !
« Dans ce lieu hors du monde » qu’est la scène, tout peut se produire. Le public chante, devine, s’esclaffe, se laisse aller aux réminiscences… « Il faut savoir que la musique est un meilleur vecteur de mémoire que le langage. Regardez si ça va réveiller certaines zones de votre mémoire … » sourit Louis Caratini qui passe du piano à la guitare, au clavecin miniature ou à la machine à écrire, fantastique instrument percussif !
Les musiques voyagent… où commence le plagiat, l’hommage, l’involontaire reprise tant certains airs font partie de nos imaginaires ?
Un exemple illustre le propos : l’un des thèmes de la 3ème Symphonie de Brahms qui sera utilisé dans Quand tu dors près de moi (Françoise Sagan pour le film d’Auric, éponyme de son roman, Aimez-vous Brahms ?) chanté par Yves Montand, puis dans Baby Alone in Babylone de Gainsbourg pour Jane Birkin, et ainsi de suite…
Tu connais la chanson? / Louis Caratini © Jérôme Quadri
,Où sont les droits d’auteur alors ? Louis Caratini cite les propos de l’écrivain Alain Damasio : «bientôt, avec le droit de propriété, sera incalculable le nombre de mots qu’il faudra payer pour les employer ! ». Peu importe d’où viennent les chansons, est-ce le Kairos grec, ce symbole de l’occasion à saisir, les mouvements des arbres ou les rêveries d’un promeneur, le souvenir d’une chanson corse ? Trenet, Higelin, Roda Gil, Angèle, Mylène Farmer, Alexandre Poulin, et tant d’autres dessinent les constellations d’un art réellement populaire : la salle entière fredonne leurs couplets. Au détour d’une volte de l’artiste, on écoute aussi pour la première fois ses chansons. De véritables pépites ! Rarement on a vu le public du Jeu de Paume se lever avec un tel enthousiasme, et un tel sourire aux lèvres !
Spectacle donné au Jeu de Paume, Aix-en-Provence, les 17 & 18 décembre 2025