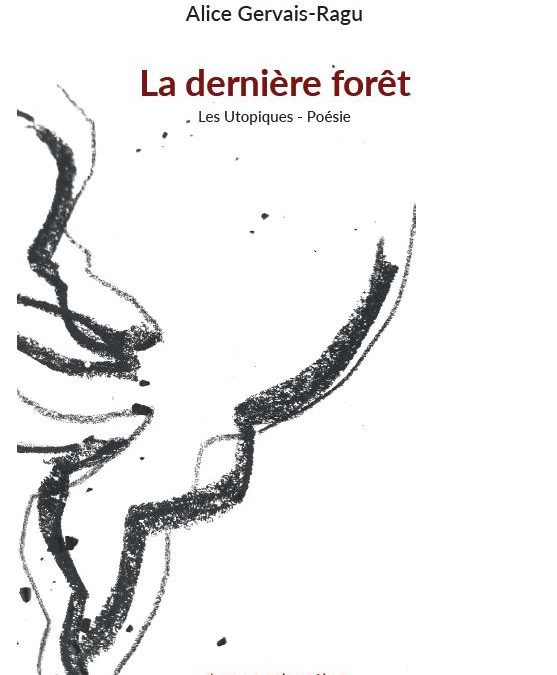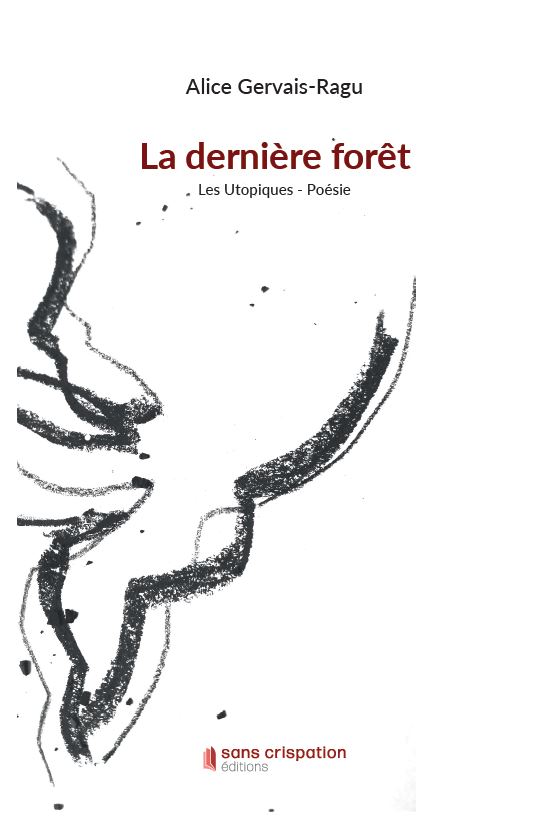Lorsque les pierres s’animent
Le quatorzième cycle de concerts Entre Pierres et Mer des Voix animées, ce merveilleux ensemble vocal « spécialiste des musiques de la Renaissance » mais pas que, est conçu comme un hommage à la féminité dans les textes sacrés du XVIème siècle.
Deux personnages émergent, la Vierge Marie bien sûr, mais aussi Marie-Madeleine dont l’image dépasse la sphère provençale qui s’enorgueillit de sa présence dans la grotte de la Sainte-Baume et le sanctuaire de Saint-Maximin (certains affirment même que le Christ serait Saint-Maximin, « le plus grand », qui se serait installé là pour être plus proche de la sainte aimée). Les mots du Cantique des Cantiques, ce long poème que le Roi Salomon, dit-on, aurait écrit pour séduire la Reine de Saba, sont l’objet de musiques qui célèbrent par des paraboles charnelles l’amour mystique.
Sofie Garcia (soprano), Esther Gutbub (mezzo-soprano), Vincent Candalot (contre-ténor), Damien Roquetty et Camille Leblond (ténors), tissent leurs voix avec une élégance et une simplicité délicate, dirigés par Luc Coadou (basse) qui, entre les chants, extrait de sa pochette un petit harmonica qui donne la note à l’ensemble. « Il n’est rien de plus démocratique que la polyphonie, sourit ce dernier, aucune voix ne cherche à dominer les autres, mais toutes s’harmonisent ». Une septième voix éclot dans le jeu des réverbérations sonores, celle des pierres de l’abbaye. Elle apporte sa pulsation aux harmoniques vibrantes au chœur des voix humaines, dessinant une forme de transcendance. C’est sans doute ce qui rend si particulière l’expérience du chant sous les voûtes du Thoronet.
Soror mea/ Voix Animées/ abbaye du Thoronet/ 23-08-2025 © Francis Vauban
Vignettes iconographiques
Toute une imagerie se décline au long du concert, baptisé Soror mea, expression empruntée au Cantique des Cantiques, « Hortus conclusus soror mea, sponsa » (Ma sœur, ma fiancée, est un jardin enclos). La symbolique du jardin et de la féminité irrigue les partitions de Manuel Cardoso avec son Mulier quae erat in civitate qui évoque le personnage de Marie-Madeleine, (« Mulier quae erat in civitate peccatrix, attulit alabastrum unguenti… » une femme qui était une pécheresse dans la ville, apporta un vase d’albâtre empli de parfum). Suit les Prudentes virgines (les jeunes filles sages) de Francisco Guerrero, la Missa « Prudentes virgines » de Alonso Lobo, messe parodique (aucune satire n’est comprise dans le terme ! il s’agit seulement de désigner la réutilisation et du développement d’une polyphonie préexistante, ici, hommage de l’élève au maître, les Prudentes virgines de Guerrero), s’appuie sur le double thème biblique des vierges folles et des vierges sages. La composition, très expressive, traduit les états d’âme des personnages en les surlignant de paysages sonores.
Auparavant, le Veni Domine de Cristobal de Moralès ouvrait le concert, précédant une série de pièces de Raffaella Aleotti, née à Ferrare, seule à ne pas être issue de la péninsule ibérique du programme, (Cristobal de Moralès, Alonso Lobo et Francisco Guerrero sont originaires d’Espagne, Manuel Cardoso du Portugal) et première femme a avoir édité ses œuvres sous son prénom de naissance, Vittoria pour ses madrigaux et sous son prénom de religieuse, Raffaella pour ses ouvrages de musique sacrée. L’image de la femme conçue tel un sanctuaire immaculé (« Sancta et immaculata virginitas ») répond à celle, allégorique du « Vidi speciosam ». « Vidi speciosam sicut columbam,/ ascendentem desuper rivos aquarum :/ cuius inaestimabilis odor / erat nimis in vestimentis eius/ et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum/ et lilia convallium. » (Je l’ai vue, belle comme une colombe, monter par-dessus le cours des eaux ; et son parfum était inestimable, ô combien, sur ses vêtements ; et comme un jour de printemps l’entouraient des floraisons de roses et les lys des vallées.)
Les voix s’étirent, les mélodies se lovent dans les mots du Roi Salomon tandis que Francisco Guerrero rappelle l’élan qui pousse l’être dans sa quête amoureuse qui est aussi quête spirituelle, Trahe me post te (« Trahe me post te, in odorem curremus unguentorum tuorum : oleum effusum nomen tuum », entraîne-moi à ta suite, nous courrons dans l’effluve de tes parfums ; huile d’onction que ton nom !). Un art de la joie se déploie au cœur de ces appels, conjuguant la beauté du monde et l’ineffable.
Re-création
Les Voix Animées nouent des partenariats avec les compositeurs d’aujourd’hui et chaque année présentent une commande dont le cahier des charges réclame une œuvre a cappella taillée sur mesure pour les voix de l’ensemble et pour l’abbaye du Thoronet, induisant un jeu savant d’harmonisation entre les pierres et les êtres humains.
En 2022, le compositeur argentin, résidant en France depuis de nombreuses années, Tomás Bordalejo, avait accepté de jouer le jeu, sur le thème retenu, Le Cantique des Cantiques et avait composé des motets spécialement pour l’acoustique du Thoronet. Deux ont été repris cette année, Osculetur me et Ego in flos campi, le second, interprété le 23 août. « En 2022, se souvient la fine musicienne Laurence Recchia, co-fondatrice des Voix Animées, le concert se déroulait plus tard et on avait fait émerger les voix de l’ombre, ce qui leur accordait une saveur toute particulière ».
La fin de journée ne permettait pas cette année un tel dispositif, mais, les cinq chanteurs (un seul ténor était requis pour cette composition), réunis en cercle dans l’abside centrale de l’abbaye, après une arrivée par les côtés de la nef, pas scandés par des œufs maracas, accordèrent à la partition une lecture d’une infinie sensibilité. L’effet sonore donnait l’impression que les voix n’étaient plus portées par des corps, mais, émanaient directement de l’invisible, aériennes. La matière éthérée modulait alternances de sons brefs jouant avec la réverbération des pierres, et passages saturés dont la densité rendait palpable d’indécelables mystères. Tomás Bordalejo confiait à l’issue du concert combien il était touché par l’interprétation des chanteurs des Voix Animées, insistant sur la relation entre les corps et la voix, le dialogue intime qui s’établit avec l’architecture dont les résonances sont aussi fascinantes qu’imprévisibles, pouvant aller jusqu’à treize secondes selon l’intensité du son et la place physique des interprètes.
Sa composition s’arqueboute sur ces paramètres ainsi que sur la matière sonore caractéristique des Voix Animées : il y a une manière particulière d’articuler les lignes mélodiques et rythmiques, une fusion subtile qui rend cet ensemble reconnaissable parmi tous les autres. Puis, il y a le Cantique des Cantiques, sourit le compositeur. Le texte sacré est d’abord un cantique d’amour infini : « Ego flos campi, et lilium convallium. / Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Sicut malus inter ligna sylvarum, sic dilectus meus inter filios » (Je suis la rose de Saron, le lys des vallées. Quel est le lys entre les épines, tel est mon aimée entre les filles. Tel est le pommier entre les arbres d’une forêt, tel est mon aimé entre les jeunes gens).
Magies…
Le concert Soror mea des Voix Animées dans le cadre du festival entre Pierres et mer a été donné le samedi 23 août 2025 à l’abbaye du Thoronet
Toutes les photos de l’article sont signées Francis Vauban.
Soror mea/ Voix Animées/ abbaye du Thoronet/ 23-08-2025 © Francis Vauban