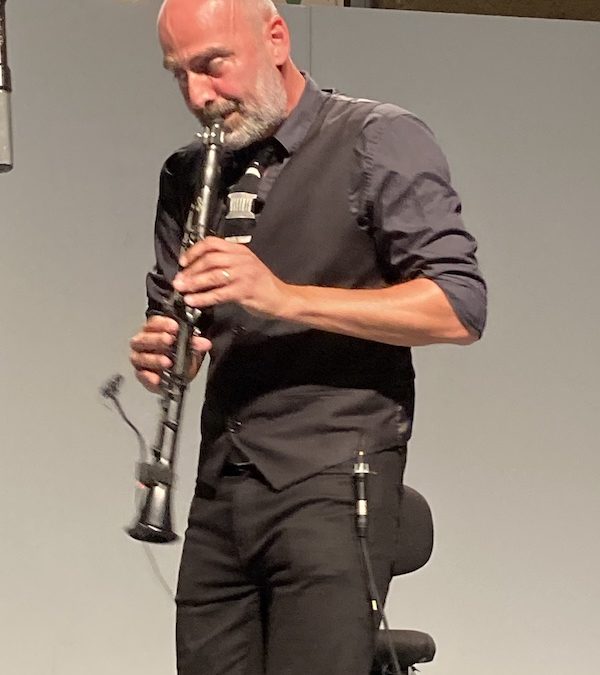La mini-série de l’été
Le festival d’art lyrique aixois ose la gageure d’enchaîner les deux opéras de Gluck, Iphigénie en Aulide et Iphigénie en Tauride. Ce double spectacle offre une deuxième partie éblouissante
Fidèle à l’esprit de Gluck, connu pour sa « réforme » de l’opéra en introduisant naturel et vérité dramatique, le metteur en scène et scénographe Dmitri Tcherniakov s’empare des deux œuvres, tissant entre elles des échos dramatiques. Le thème du sacrifice est exploré, questionnant les œuvres à travers des références aux travaux de René Girard et Simone Weil : le sacrifice d’Iphigénie entraîne une guerre soldée par des milliers morts dont le décompte (celui de la guerre en Ukraine ?) sera affiché sur le rideau de scène fermé entre les deux opéras dirigés avec finesse par la cheffe Emmanuelle Haïm.
Un théâtre bourgeois ?
Iphigénie en Aulide s’orchestre dans un décor stylisé, aux armatures doublées de tubes de néons qui mettent en évidence les pièces du palais des Atrides curieusement très « intérieur bourgeois » derrière des toiles légères. Un jeu s’établit entre les codes du « théâtre bourgeois » et la fresque antique, apportant un intéressant décalage.
Les personnages en costume de ville viennent conforter cette impression, de même que la mièvre dispute amoureuse entre Achille (Aladair Kent) et Iphigénie (Corinne Winters) ou l’intrusion du photographe de cérémonie. Mais le songe d’Agamemnon (Russel Braun), superbement théâtralisé dans une esthétique du surgissement, mettait d’emblée en évidence les enjeux tragiques. Calchas (Nicolas Cavallier) impose la volonté cruelle de la déesse malgré Clytemnestre (Véronique Gens) souveraine dans ses plaintes tandis que la fin ambiguë avec la substitution de la victime par la déesse elle-même (Soula Parassidis) est d’une poétique intelligence.
Iphigenie en Aulide © Festival d’Aix
Musicalement irréprochable, l’œuvre nous laisse pourtant sur notre faim. Sans doute la partition ?
Tension tragique
Après un petit clin d’œil à Dumas, « une vingtaine d’années plus tard », Iphigénie grelotte dans les décors mis à nus dans leur sobriété tubulaire. Les costumes évoquent une « colonie pénitentiaire », dans des éclairages qui peuvent blesser tant ils sont crus (Gleb Filshtinsky)… La terre des Scythes est bien éloignée des douceurs grecques ! Prêtresse sacrificatrice d’Artémis, l’héroïne doit sacrifier, à l’injonction du roi Thoas (Alexandre Duhamel), son frère Oreste (Florian Sempey) qui rivalise d’abnégation avec son ami Pylade (Stanislas de Barbeyrac). Bouleversent la tension dramatique et tragique, l’écriture exigeante et somptueuse de l’œuvre, son interprétation qui tutoie le sublime et sait être éloquente sans vouloir d’effets.
Iphigénie en Tauride Festival d’Aix-en-Provence 2024 © Monika Rittershaus
L’incroyable Corinne Winters, l’Iphigénie des deux opéras, exprime avec une vérité confondante les émotions qui la traversent. Les échos de la pièce précédente hantent les personnages de leurs fantômes. La mémoire des terreurs et des erreurs passées ne peut contrecarrer celles à venir, il faut un « deus ex machina » pour réconcilier les êtres et leur donner un avenir plus serein. Vision pessimiste du monde aux sombres échos actuels.
« Iphigénie en Aulide » et « Iphigénie en Tauride » sont donnés jusqu’au 23 juillet, au Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence.