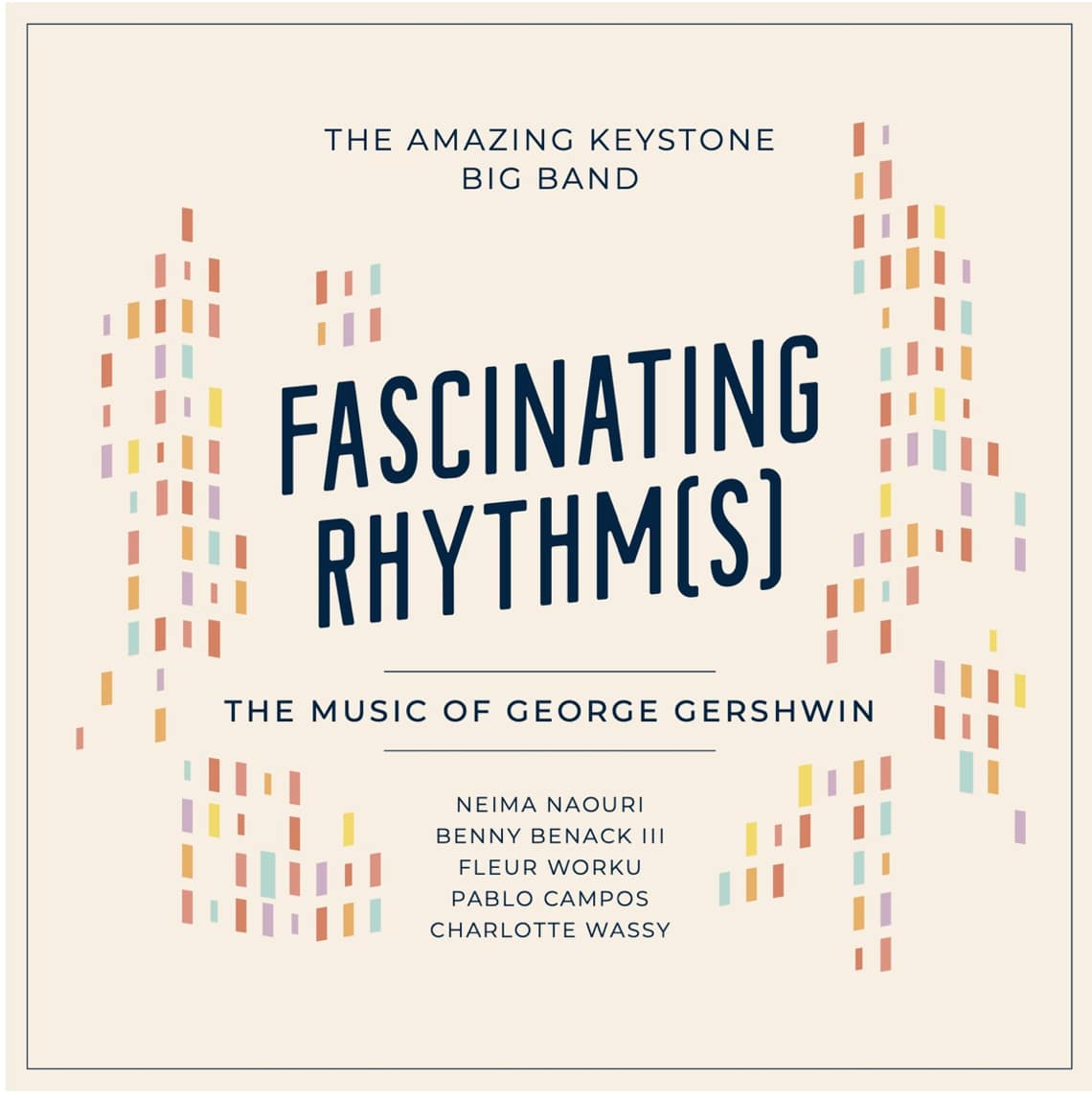Joyeux anniversaire Monsieur William Christie !
Il a fêté son quatre-vingtième anniversaire le 19 décembre 2024, occasion pour l’ensemble qu’il a fondé en 1979, Les Arts Florissants, de multiplier les concerts et les surprises, à la Philharmonie de Paris d’abord qui les accueille en résidence depuis 2015, puis en une tournée d’anthologie qui a fait escale au Grand Théâtre de Provence. « Le plus français des chefs américains » (il est né à Buffalo un 19 décembre 1944 mais a été naturalisé français en 1995) était entouré ce soir-là d’une phalange de treize de ses musiciens et de six chanteurs issus de l’académie baroque « Le Jardin des Voix » qu’il a créé à Thiré en Vendée, il y a plus de vingt ans, véritable pépinière d’artistes.
Au programme un florilège d’extraits d’opéras baroques français tenait la salle d’un GTP comble dans les filets d’une magie que rien ne semblait pouvoir effacer. Bill, c’est ainsi que le chef aime être appelé, retraçait ainsi les productions lyriques et les grands enregistrements qui ont jalonné sa carrière.
Avec la feuille de salle était distribué un petit livret contenant les paroles des airs chantés permettant aux auditeurs de s’imprégner du sens de ce qui serait interprété. Le travail de l’ensemble est adepte de la manière « historique » dans son approche des œuvres. Il ne s’agit pas d’ une reconstitution qui serait simplement documentaire mais plutôt d’accomplir un réel travail de création en utilisant les moyens techniques les plus proches possibles de ceux qui étaient à la disposition des compositeurs. Aussi, les instruments utilisés sont, soit d’époque, soit des copies fidèles aux originaux. Les cordes sont en boyau et les archets de type baroque.
William Christie © Caroline Doutre
Ce qui accorde à l’ensemble, outre la fluidité et la complicité sensible qui habitent ses performances, une sonorité particulière. Le son et le style sont ainsi étudiés avec une grande précision. Sans doute parmi les caractéristiques les plus évidentes se trouvent les « r » roulés de la prononciation restituée des siècles baroques. Les chanteurs savent préserver un équilibre subtil entre la scansion parlée et les mélodies, dans un effet de naturel confondant. Sans partitions, ils jouent vraiment les saynètes des divers opéras en version de concert mais légèrement mis en espace. Ils font vivre avec une espiègle liberté les personnages et les remuements de leurs âmes, tandis que l’orchestre, d’une superbe cohésion sous la houlette de « Bill » placé au centre des musiciens, derrière son clavecin ou son orgue, déploie une palette aux ondoiements moirés. Ici, la direction tient de l’évidence par sa précision, sa simplicité, son intelligence, son sens aigu des nuances. Un fil se tissait depuis la Médée de Charpentier à l’Atys de Lully puis un « parcours » Rameau visitant Pygmalion, Les Fêtes d’Hébé, Platée, Hippolyte et Aricie, enfin Les Indes Galantes et leur « tube », Forêts paisibles (Acte III, Les Sauvages).
Les voix des jeunes artistes, Ana Vieira Leite (soprano), Rebecca Leggett, Juliette Mey (mezzo sopranos), Richard Pittsinger, Bastien Rimondi (ténors) et Matthieu Walendzik (baryton). L’écrin instrumental accompagnait avec une subtile élégance les solistes égrenant grands airs, duos, tutti au tissage complexe, suscitant les exclamations enthousiastes du public. On rit, on s’émeut, on se laisse emporter dans les mélodies aux ornementations qui jamais ne cherchent à alourdir mais semblent être des émanations naturelles d’une intention, d’une respiration.
Sophie Daneman © Juliette Le Maoult
On retiendra entre autres délices la très belle Médée campée par Rebecca Leggett, la voix lumineuse d’Ana Vieira Leite, celle très incarnée de Bastien Rimondi, les superbes ensembles, le théorbe de Thomas Dunford, la vivacité des instrumentistes souvent debout comme emportés par le flux irrépressible de leurs partitions…
Ce concert d’anniversaire recelait une surprise concoctée par l’orchestre : la venue de la soprano anglaise Sophie Daneman qui rappelait ses débuts avec William Christie qui a « changé sa vie, comme celles de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui ». Tel un enfant sage, il se tint sur une petite chaise pour l’écouter (seule entorse à la programmation française) dans un air de Théodora de Haendel, voix subliment aérienne et travaillée en dentelle fine.
Un anniversaire placé sous le signe de l’amour plus fort que la guerre…
Concert donné le 15 février 2025 au Grand Théâtre de Provence
Une version plus ancienne de Forêts paisibles des Indes Galantes par Les Arts Florissants
Le nom de l’ensemble est une reprise du titre de l’opéra de chambre (ou « idylle en musique ») du compositeur français Marc-Antoine Charpentier, Les Arts florissants (« Les Arts florissans », dans sa graphie originale)