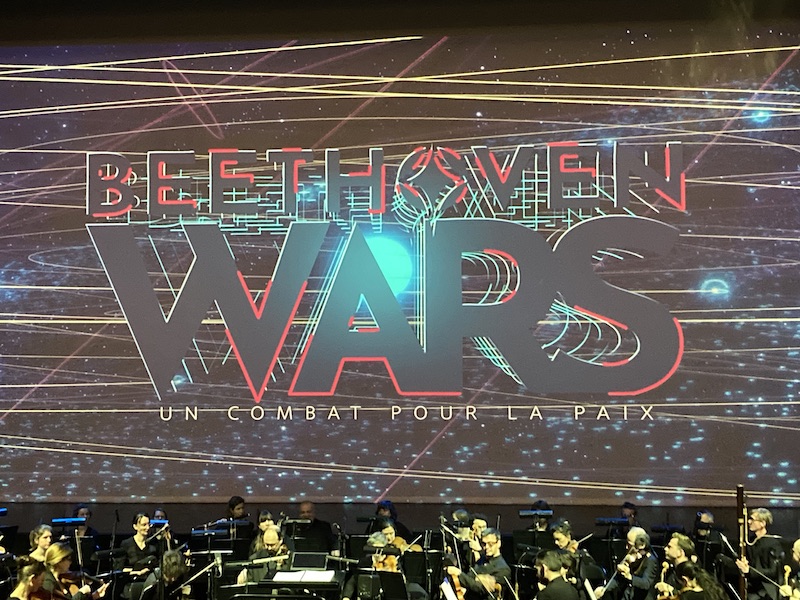Du poison de la nostalgie
En résidence au Chantier du 24 au 28 mars, le groupe Tchayok offrait la primeur de son travail de recherche lors d’un concert le dernier jour à La Fraternelle de Correns.
Les trois musiciens, animés d’une passion commune pour les musiques slaves et tziganes, explorent le champ immense des mélodies et chants qui varient au fil des régions, des reliefs, des villages, des histoires.
Les deux frères d’origine russo-ukrainienne, Romain et Vladimir Gourko, se présentent comme des « enfants de la balle », traînés dans les cabarets russes de Paris dès leur plus tendre enfance par leurs parents en quête du « poison de la nostalgie ». Plus de 400 000 russes émigrèrent à Paris dans l’entre-deux guerres apportant avec eux leur culture, leurs chants, leurs musiques, qui se jouaient dans l’écrin des cabarets et de la vie nocturne. Les artistes allaient d’un cabaret à l’autre tout au long de la nuit afin de multiplier leurs cachets, sourient les musiciens lors de la rituelle rencontre qui précède les concerts du Chantier.
Tchayok à Correns 2025 © M.C.
Si les guitares à six cordes font partie de l’instrumentarium (« nous n’avons pas apporté la « sept cordes » qui est une guitare russe » explique Vladimir Gourko), les balalaïkas attirent l’œil des spectateurs. Les origines de cet instrument slave par excellence sont évoquées : son ancêtre serait la domra, apparue au XVIème siècle, introduite en Russie par les Tatares. Mais le tsar de Russie, Alexis Mikhaïlovitch, sans doute sous l’influence de l’église russe, décréta l’interdiction des instruments de musique en 1648. C’est ainsi que la balalaïka serait née : facile à fabriquer, elle était assez rudimentaire et n’importe quelle personne avec quelques notions de menuiserie pouvait en construire une. C’est ce qui explique la multitude des modèles, la disparité des accords des débuts de l’instrument qui, aujourd’hui se décline en six, voire sept modèles, la piccolo, la prima, la secunda, l’alto, la basse, la contrebasse et enfin la subcontrebasse.
Si les deux frères évoluaient entre guitares et balalaïka prima, leur complice Yoann Godefroy délaissait parfois sa contrebasse pour la balalaïka contrebasse.
L’instrument aux dimensions imposantes et toujours triangulaire est difficile à manier, même s’il est posé sur sa pique comme un violoncelle, demande des contorsions pénibles à l’instrumentiste.
La dureté des cordes (toujours trois et métalliques quelle que soit la taille de la balalaïka) rend le jeu à la main douloureux et un médiator particulier, un large rond de cuir, vient suppléer aux phalanges !
Tchayok à Correns 2025 © M.C.
Les musiciens présentent leurs instruments avec une fine intelligence, font écouter la différence entre les cordes nylon et les cordes de métal des guitares, précisant leurs emplois selon les effets recherchés, expliquent leurs fonctions, mélodies pour les guitares et les balalaïkas prima, percussions grâce à ses attaques précises et clinquantes pour la contrebasse.
Questionnés avec érudition par Frank Tenaille, directeur artistique du Chantier, ils retracent la musique des cabarets, sa transmission, ses voyages au fil des siècles : « il n’y a pas de musique russe mais des musiques russes », insistent-ils, rappelant les grands balalaïkistes, véritables « bibliothèques vivantes » qui connaissent des centaines et des centaines de chants, de mélodies, et leurs particularités locales. La majorité des musiciens étant tziganes, les thèmes étaient transmis oralement et prenaient les caractéristiques de chaque pays traversé.
Peu de concerts pour les plus grands interprètes ! Ils préféraient de loin les mariages, bien mieux payés, au cours desquels ils pouvaient jouer huit heures d’affilée, interprétant les morceaux demandés, recevant pour chacun un pourboire glissé dans le corps de l’instrument !
Voyage en terres slaves
Les musiques voyagent et aux exilés qui ne peuvent plus retourner dans leurs lointaines contrées, elles racontent les vents froids, les neiges, les fêtes, les tristesses.
Les trois musiciens reprenaient dans ce périple des morceaux venus de Russie, de Serbie, de Roumanie, d’Ukraine, de Bulgarie de Géorgie ou encore d’Arménie.
Les rythmes s’entremêlent, boiteux parfois, comme pour l’élan d’une danse.
La guitare prend des allures de mandoline avec ses trémolos, les balalaïkas sonnent avec une délicieuse acidité, offrant une palette étonnamment riche avec seulement trois cordes !
Les histoires fleurissent : amours contrariées de deux arbres amoureux mais séparés par une rivière, tandis que les mains s’ouvrent comme des éventails sur les cordes des balalaïkas, passion pour les chevaux presque aussi forte que celle de l’or et des bijoux, comptines enfantines pour s’endormir, danses auxquelles le monde est convié… La poésie de Pouchkine s’immisce au cœur des mélodies avec ses songes en miroir. Aux pièces déjà publiées dans les deux premiers albums du groupe, Zavarka et Touda Siouda, s’ajoutent des créations nouvelles, nées durant la résidence. Les rythmes et les phrasés de ces dernières sont bouleversants d’intensité et d’inventivité. S’y retrouvent les parcours éclectiques des musiciens passés par d’autres styles musicaux, jazz, brésilien qui se nouent aux inspirations tziganes avec une intelligence et une verve rare.
Concert donné le 28 mars 2025 à La Fraternelle de Correns grâce à l’initiative du Chantier
Le spectacle fait aussi partie de la programmation du festival Mus’iterranée
Ces très belles chansons, Deves i Rat & Kaï Ione, ont été interprétées ce soir-là. Elles font partie du film soviétique réalisé par Emil Loteanu en 1976 d’après des nouvelles de Maxime Gorki, Les Tsiganes montent au ciel.