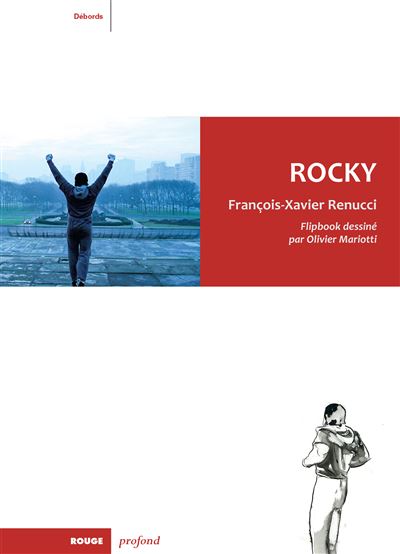Elle a dit « NON! »
Andromaque de Racine passionnément interprétée au Jeu de Paume dans la subtile mise en scène d’Yves Beaunesne
Ils aiment tous mais sans réciprocité : le célèbre résumé, Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector, tué par le père de Pyrrhus, installe d’emblée la pièce dans un cercle d’impossibilités que rien se peut résoudre. Chacun s’enferme dans l’orbe de sa passion jusqu’à la folie. La démesure, l’hybris de la Grèce antique, se déploie alors, défiant la mesure, et mène, inexorable, à la tragédie qu’irrigue de son souffle l’ampleur des vers de Racine.
Aux sources orientales
La scénographie s’inspire de la cour d’un palais de Beyrouth, verrière élégante dont les vitres en partie brisées laissent percevoir dans l’ombre les musiciens qui, entre chaque acte de la pièce, se livrent à de courts intermèdes chantés, accompagnés par un accordéon et un violoncelle. La performance des acteurs qui passent de la « partition » racinienne pliée avec aisance au tempo de l’alexandrin, à la partition musicale est à saluer : aucune rupture de ton, mais une élégante fluidité. La musique composée spécialement pour cette œuvre par Camille Rocailleux sait préserver les couleurs de la mise en scène par un tissage très fin entre les voix et les instruments, renvoyant par ses mélodies et ses accords aux sources antiques. Le texte des chants condense quelques extraits de l’Andromaque d’Euripide. Les sonorités du grec ancien dans sa prononciation érasmienne ancrent le sujet dans son histoire, tandis que les mots de Racine prennent un tour tragiquement actuel : lorsqu’Andromaque rappelle « cette nuit cruelle » où sa ville, Troie, prise par les Grecs, fut détruite, les « cris des vainqueurs » se mêlant « aux cris des mourants », combien d’échos actuels sont éveillés en nous !
Andromaque © Dominique Houcmant
Transmettre
On pouvait s’étonner au départ du choix d’Yves Beaunesne pour incarner le confident d’Oreste de Jean-Claude Drouot, l’immense acteur qui ne peut en aucun cas être réduit à la mythique série Thierry la Fronde dont il fut le héros. Pylade est en effet l’ami d’Oreste. « Il n’est pas contradictoire d’imaginer un ami beaucoup plus âgé. Pylade met en garde Oreste, tente de le modérer, de l’avertir. Son expérience lui donne une épaisseur », explique le metteur en scène. On se laisse séduire par ce choix. Pylade (Jean-Claude Drouot) fait figure de sage, sacrifié (seule entorse à la pièce de Racine) par la folie d’Oreste, il meurt en essayant de protéger son ami de lui-même. L’intrigue est portée avec puissance par la talentueuse phalange de comédiens réunis par le metteur en scène ; Milena Csergo , épaulée par sa confidente Céphise, Johanna Bonnet-Cortès, campe une Andromaque hiératique et émouvante, murée dans son refus d’épouser Pyrrhus, bouleversant Léopold Terlinden capable de tout sacrifier à son amour, malgré les injonctions de Phoenix, son gouverneur, Christian Crahay, tandis que, tout aussi excellent, Oreste, interprété par Adrien Letartre, donne la réplique à une Hermione fantasque, Lou Chauvain, qui oscille entre l’attitude d’une noble princesse et celle d’une enfant capricieuse et butée, secondée par sa confidente, Cléone, spirituelle Mathilde de Montpeyroux. Ces deux dernières apportent la dimension du rire et de l’humour de la pièce.
La légèreté accorde par effet de miroir davantage de profondeur aux enjeux, souligne la spirale de la folie qui emporte tout, sous le regard muet du jeune Astyanax (Niccolo Wagner à l’écran) projeté sur le décor de fond de scène, catalyseur de toutes les tensions. C’est lui dont les Grecs par l’entremise d’Oreste veulent la tête, craignant que, devenu grand, l’enfant ne souhaite venger son père, Hector et sa ville, Troie. Son sort devient objet de chantage de la part de Pyrrhus… Le passé hante le présent, sa cruauté infinie empoisonne les survivants et leurs relations : la guerre de Troie continue ses ravages bien après sa fin. Les blessures ne se referment jamais vraiment… Hermione souhaiterait que l’Épire, royaume de Pyrrhus, soit une nouvelle Troie, et elle une sorte de seconde Hélène, tandis que Pyrrhus cherche à abolir cette relation au passé : il souhaite détruire la mémoire de ses actes anciens pour une nouvelle naissance scellée par un mariage avec Andromaque. Cette dernière, femme, captive, assujettie à un destin qu’elle ne maîtrise plus, dit « non » et par là, infiniment contemporaine, dresse une image neuve et intemporelle de la résistance.
Andromaque © Dominique Houcmant
La finesse du jeu des acteurs, la limpidité de leur diction, l’intelligence des textes, la pertinence des variations, la beauté des lumières qui sculptent l’espace scénique, tout concourt à construire une lecture aiguisée de la pièce de Racine. Un diamant taillé !
Du 2 au 4 février, Jeu de Paume, Aix-en-Provence